(Baptême d’Abel – Journée mondiale des pauvres)
Les paroles de Jésus sont un peu terrifiantes. Elles le sont en elles-mêmes, parce qu’elles annoncent des catastrophes toujours plus grandes, que personne ne veut vivre un jour. Elles le sont d’autant plus que nous pouvons reconnaître en elles des événements qui ont cours dans les temps qui sont les nôtres : on se dresse nation contre nation, il y a des grands tremblements de terre, des famines et des épidémies, des chrétiens, en bien des endroits du globes, sont persécutés et livrés aux prisons… Les temps qu’annoncent Jésus seraient-ils donc arrivés ? Mais on sait aussi que ces catastrophes ont malheureusement eu cours tout au long de l’histoire. Et qu’en tout temps, elles ont été l’occasion pour certains d’annoncer la fin du monde, qui n’est encore jamais arrivée. Alors que font ces paroles dans la bouche de Jésus ?
Regardons l’auteur de l’évangile : Saint Luc. Il écrit à des juifs qui connaissent la tradition et les écrits juifs. Il écrit aussi à des chrétiens récemment convertis, aux premières églises chrétiennes : il est l’auteur du livre des Actes des Apôtres, le livre qui décrit la vie des premiers chrétiens. Ses destinataires savent donc que le Temple de Jérusalem, dans lequel Jésus est lors de ce passage de l’évangile, a été totalement détruit à l’été de l’année 70, et que la ville a été mise à sac. Et pour en parler, Jésus ne fait que reprendre des passages apocalyptiques des prophètes, notamment du prophète Daniel (vivant 6 siècles avant Jésus), et que les lecteurs de Luc connaissent. Ils comprennent alors que la chute du Temple est peut-être la fin d’un monde, connu et rassurant, mais pas la fin du monde. Pour parler du futur, Jésus utilise des mots déjà utilisés dans le passé. Une façon de mettre à distance les prédictions annoncées : elles ne sont précisément pas des prédictions de l’avenir. Ces catastrophes sont malheureusement le lot de toutes les générations, et il convient de ne pas en faire des signes particuliers d’une quelconque apocalypse. Les événements de l’histoire, aussi dramatiques soient-ils, ne sont pas des annonces de la fin des temps. De même, les premiers chrétiens connaissent la persécution : les paroles mises par Saint Luc dans la bouche de Jésus visent à encourager ces disciples de la première heure à persévérer dans la foi et à continuer à rendre témoignage.
Les paroles de Jésus nous encouragent donc à ne pas avoir peur de tout ce qui peut nous arriver et arriver à notre temps ou à notre planète. Ces événements font partie de la vie, et pour certains de notre responsabilité, quand il s’agit de choix politiques ou sociétaux à poser. Il ne faut pas y voir trop vite la fin des temps. Mais au milieu des tribulations de ce temps et de nos vies, Jésus nous invite à tenir. A tenir « avec persévérance ». A tenir une espérance dans la foi. Il me semble que deux signes nous sont donnés ce matin pour tenir ainsi notre place, deux signes dont parle déjà Jésus : le langage et la sagesse (« C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. »)
D’abord, la sagesse des pauvres. Nous vivons ce dimanche la journée mondiale des pauvres qui coïncide, nous l’avons entendu, avec la journée mondiale du Secours Catholique. Les pauvres, au milieu des chaos familiaux, sociaux, matériels, intérieurs qu’ils peuvent vivre – et peut-être à cause des guerres, des catastrophes naturelles et des désordres mondiaux – sont nos maîtres. Comme le souligne le pape dans son message : « Le pauvre peut devenir témoin d’une espérance forte et fiable, justement parce qu’il la professe dans des conditions de vie précaires, faites de privations, de fragilité et d’exclusion. Il ne compte pas sur les certitudes du pouvoir et des biens ; au contraire, il les subit et en est souvent victime. Son espérance ne peut reposer qu’ailleurs »[1]. Il dit plus loin : « Les pauvres ne sont pas des objets de notre pastorale, mais des sujets créatifs qui nous poussent à trouver toujours de nouvelles façons de vivre l’Évangile aujourd’hui »[2]. Les plus pauvres de notre temps, parfois à nos portes, parfois même dans nos maisons, sont nos maîtres pour apprendre à faire confiance en l’autre et au Tout Autre, et nous enracinent existentiellement dans la foi au Fils de l’Homme pour traverser les difficultés du jour.
Ensuite, le langage de la croix, qui est aussi le langage du baptême. Ce baptême qu’Abel va recevoir et qui oriente aussi notre vie. Ce baptême qui nous lie viscéralement au Christ, dont l’amour est plus fort que tout. A cause de notre baptême, rien ne pourra nous séparer du Christ, et donc rien ne peut plus nous faire peur. Il n’y a pas lieu de céder à une quelconque panique, ni même au pessimisme. Au contraire, nous voilà, par le langage du baptême que nous avons reçu, témoins et acteurs d’une espérance qui vient confondre toutes les forces contraires et désespérantes. Ne soyons pas des prophètes de malheur qui annoncent que tout est fichu, mais des prophètes de bonheur qui annoncent que l’amour du Christ traverse l’histoire et ses tribulations, et qu’il compte même les cheveux de notre tête pour n’en perdre un seul !
En cette eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur. Recevons de lui cette sagesse et ce langage. Redisons-lui notre confiance. Et portant dans notre prière tous les événements tragiques de notre monde, enracinons en lui notre espérance.
Amen.
P. Benoît Lecomte
[1] Message du pape Léon XIV pour la Journée Mondiale du Pauvre 2025, n°2
[2] Idem, n°6
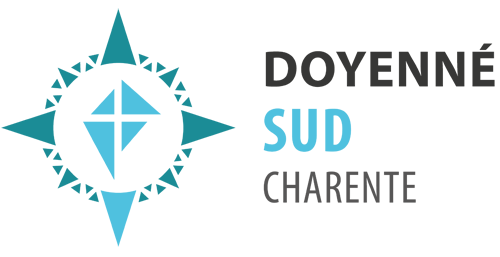






Laisser un commentaire