Où en est la démarche synodale ?
Rappelons-nous, au moins 300 personnes, cet hiver ont participé sur notre doyenné du Grand Angoulême, le plus souvent dans des groupes paroissiaux, à l’élaboration de convictions sur l’Eglise de demain à la demande du pape François. L’Eglise dont on rêve, osant parfois une parole prophétique…
L’étape nationale vient d’être vécue. Nous lisons çà et là quelques articles dans la presse concernant la session extraordinaire de l’épiscopat français tenue à Lyon les 14 et 15 juin. Chaque évêque y était présent avec un représentant laïc de chaque diocèse. Cette synthèse nationale est disponible sur le site de la C.E.F. https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
J.M. Guenois, pour le Figaro, souligne ces quelques points :
« Mariage des prêtres, femmes diacres ou prêtres, transparence dans les décisions paroissiales, révision de la liturgie… Les propositions issues des diocèses de France pour le synode sur la synodalité, voulu par le pape, pourraient bouleverser l’ordre établi dans le sacerdoce des prêtres. « Une réelle reconnaissance » envers eux est pourtant soulignée.
Elles ont été validées, mercredi (15 juin) à Lyon, par les évêques, puis transmises « telles quelles » à Rome, accompagnées d’une lettre qui les justifie et les met en perspective. Jamais l’Église de France n’avait voté et assumé un texte aussi radicalement réformateur, en particulier sur le sacerdoce. […]
S’achève ainsi la première phase d’un synode mondial sur la gouvernance de l’Église, convoqué en 2021 par le pape François. À Rome, d’ici à décembre 2022, s’ouvrira une seconde phase qui va rassembler l’ensemble de ces propositions nationales pour préparer la tenue effective de ce synode au Vatican, en octobre 2023.
Le document français s’intitule « Collecte des synthèses synodales ». […]
Les dix propositions posent un diagnostic sévère sur l’exercice actuel du sacerdoce catholique : « autoritarisme, difficultés dans les relations avec les femmes, attitude surplombante plus que fraternelle ». Les évêques proposent donc « que le célibat des prêtres soit laissé au libre choix de ceux-ci, de sorte que l’ordination presbytérale et le mariage soient compatibles ».
Autre grief, la « criante disproportion entre le nombre de femmes engagées » et celles « qui sont en situation de décider ». Ce qui engendre « d’innombrables blessures », une « attente criante », une « révolte ». D’où « de nombreuses demandes pour que les femmes puissent recevoir l’ordination diaconale » et qu’elles puissent être chargées de « la prédication ». Ce qui serait un « premier pas ». Certains voudraient qu’elles « puissent être ordonnées prêtres ».
Les évêques appellent aussi à une « diversification des liturgies au profit des célébrations de la parole », avec une « place centrale pour la méditation des écritures ». Selon eux, l’eucharistie est certes « essentielle », mais sa liturgie peut être un « lieu de tension » : tant pour « l’irrecevabilité du langage » de l’Église – trop complexe pour les fidèles – , que pour les « exclus des sacrements (personnes homosexuelles, divorcés remariés) ».
150 000 catholiques ont élaboré ces cahiers de doléances, soit 10 % des pratiquants, mais « peu de jeunes et de jeunes adultes », reconnaît l’épiscopat, qui note aussi « la difficulté pour beaucoup de prêtres à reconnaître l’intérêt de ce synode ». (…) »
On pourra noter d’autres points dans la synthèse de l’Église de France, comme au sujet de la formation des Chrétiens liée à celle des futurs prêtres, revisitant le schéma actuel des séminaires : « On trouve à plusieurs reprises la suggestion d’une formation commune aux ministres ordonnés, aux ministres institués et à tous les baptisés. D’autre part, c’est dans la formation humaine des futurs prêtres (les qualités relationnelles, l’équilibre personnel, la capacité à gouverner et à communiquer) que les synthèses marquent la nécessité d’une évolution ».
Ou encore sur le sens même de la parole de Dieu, bonne nouvelle pour toute personne : « Les personnes en grande précarité identifient dans la lecture commune des Écritures un fondement de la vie ecclésiale. En méditant les textes, chaque participant expose sa vie et sa parole à la Parole de Dieu et peut entendre les appels que Dieu adresse à chacun et à l’Église. Ainsi, tous peuvent trouver leur place : personnes très précaires ou non, chrétiens pratiquants ou non… »
A suivre donc !
Laurent Maurin – 17 juin 2022
Regarder de l’avant
L’évangile de ce jour (Luc 9, 51-62) nous invite à regarder de l’avant.
C’est ce qui est fait avec la démarche synodale lancée il y a un an par le pape François. Tous les diocèses du monde se sont donc retrouvés en synode au cours de cette année. Notre paroisse ND des Sources y a participé à travers 4 assemblées paroissiales où au total plus de 60 paroissiens ont donné leur sentiment et leur point de vue sur l’avenir de l’Eglise.
Il y a quelques jours, tous les diocèses de France avec tous les évêques et des représentants laïcs ont produit une synthèse nationale à partir de toutes les contributions. Notre diocèse d’Angoulême était représenté par une personne de notre paroisse, Yolande Lallemand. Lorsque nous lisons cette synthèse nationale, nous avons le plaisir de retrouver plusieurs points énoncés par les chrétiens d’ici dans les différents groupes de parole ! Nous ne pouvons que nous en réjouir ! Deo gratias !
Voici quelques extraits significatifs de cette synthèse pour l’Eglise de France, pour dire l’Eglise que nous souhaiterions…
Parmi les pratiques spirituelles évoquées, la méditation des Écritures en petites fraternités apparaît centrale. Elle est vue comme un ressourcement personnel, une manière pour l’Église de répondre avec pertinence à la quête de sens de nos contemporains, dans une pratique qui conjugue profondeur et liberté. Elle est également identifiée comme une source de vie communautaire, puisque les appels de Dieu à nos communautés se laissent découvrir dans l’écoute commune de sa Parole. De plus, l’aspect missionnaire est notable : de nombreuses fraternités constituées autour de la méditation de la Bible parviennent à intégrer des personnes qui ne se sentent pas à l’aise dans les assemblées paroissiales.
Par ailleurs, les attentes sont fortes quant aux homélies : nombreuses sont les déceptions exprimées lorsque la prédication ne s’appuie pas suffisamment sur la Parole de Dieu et ne nourrit pas la vie quotidienne des baptisés. Un élargissement de la prédication lors de l’eucharistie aux laïcs, et spécifiquement aux voix féminines, est une demande récurrente. Une meilleure formation biblique des baptisés est souhaitée, ainsi qu’une réelle formation des pasteurs à l’homilétique ; cela concernerait aussi toute personne laïque appelée à la prédication. […]
La synodalité est un apprentissage, car l’écoute, le dialogue et le discernement s’approfondissent chemin faisant. Il existe déjà des lieux et des cadres de dialogue fraternel dans l’Église, au plan des paroisses, des doyennés ou des diocèses. Lorsque la parole y est reçue avec bienveillance, ce sont les lieux d’un cheminement synodal effectif, reconnu comme tel dans les synthèses. Cet apprentissage de la synodalité invite à des conversions : se laisser instruire par la manière dont la Parole de Dieu est reçue par les baptisés, apprendre à ouvrir des chemins plutôt qu’à donner des réponses. […]
On trouve à plusieurs reprises la suggestion d’une formation commune aux ministres ordonnés, aux ministres institués et à tous les baptisés. D’autre part, c’est dans la formation humaine des futurs prêtres (les qualités relationnelles, l’équilibre personnel, la capacité à gouverner et à communiquer) que les synthèses marquent la nécessité d’une évolution.
Il est régulièrement souhaité que le célibat des prêtres soit laissé au libre choix de ceux-ci, de sorte que l’ordination presbytérale et le mariage soient compatibles. […] [1]
Sur la question de la place faite aux femmes dans l’Église, les synthèses perçoivent une urgence ainsi que d’innombrables blessures. Les blessures viennent des difficultés dans les relations avec les prêtres et les évêques, de la criante disproportion entre le nombre de femmes engagées dans l’Église et de femmes qui sont en situation de décider. Si le service des femmes est apprécié, leur voix paraît ignorée. Qu’elles contribuent effectivement aux multiples discernements des Églises locales est l’objet d’une attente criante. C’est ici qu’une urgence est identifiée dans bien des synthèses. La manière dont les femmes sont traitées dans l’Église n’est pas ajustée à la mission de celle-ci, à une époque où l’égalité entre les hommes et les femmes est devenue une évidence commune. Les douleurs sont d’autant plus grandes qu’elles procèdent de cette conviction : l’Église se prive ainsi d’innombrables charismes et de possibilités réelles de sortir de l’entre-soi clérical.
« Sur la place des femmes tout le monde bouge sauf l’Église ». […] Nous sommes révoltées par l’inégalité entre les femmes et les hommes, et ce dès le plus jeune âge, au sein de l’Église. Nous souhaitons un autre modèle pour nos enfants. » Mission de France (contribution d’un groupe de femmes trentenaires)
On lit aussi de nombreuses demandes pour que les femmes puissent recevoir l’ordination diaconale. Le ministère des diacres n’étant guère identifié dans sa spécificité, cela renvoie à l’attente d’« un premier pas symbolique important » (Promesses d’Église) – et à la requête, déjà évoquée, que la prédication puisse être prononcée par des femmes pendant la messe. Un peu moins souvent, même si elle est largement récurrente, on trouve la demande que les femmes puissent être ordonnées prêtres. […]
À tous les niveaux, les communautés ecclésiales ont intérêt à se constituer à partir des charismes de chacun ; cela permet à chaque baptisé d’exercer la responsabilité qui lui revient et de prendre sa part de la mission dans la société et dans l’Église. Les synthèses expriment de nombreuses tensions à ce sujet, par exemple l’expérience récurrente d’abus de pouvoir, l’aspect « pyramidal » de la gouvernance, la peur du conflit qui invite à cacher les problèmes plutôt qu’à les traiter, l’arrivée d’un nouveau curé qui impose une direction contraire à celle qui prévalait jusqu’alors dans une paroisse… […]
À l’échelle des diocèses, on trouve trois types de demandes. D’abord, que d’authentiques contre-pouvoirs existent – par exemple avec des conseils composés de baptisés élus –, car la dimension synodale de la gouvernance ne dépend aujourd’hui que de la bonne volonté des évêques. Ensuite, l’existence d’une réelle subsidiarité, qui ne consiste pas à déléguer seulement les tâches, mais aussi à déléguer la prise de décisions au niveau concerné ! Enfin, que les laïcs appelés à des responsabilités se voient proposer une formation appropriée, qui puisse aussi bénéficier à l’ensemble des baptisés. L’enjeu est ici la réception du concile Vatican II et de son enseignement sur l’Église. […]
Ces mots rejoignent trois aspirations. La première, déjà nommée, concerne la diversification des liturgies au profit de célébrations de la Parole, de temps de prière qui accordent une place centrale à la méditation des Écritures. La seconde, moins fréquente, rappelle l’importance des pèlerinages et de la piété populaire. La troisième envisage une formation liturgique renouvelée, pour faire face à ce que beaucoup de synthèses pointent comme l’irrecevabilité du langage courant dans l’Église.
Enfin, les mentions d’un profond désaccord avec le refus que des filles servent à l’autel ou que des femmes entrent dans le chœur pour un service liturgique sont si nombreuses, qu’on ne peut douter d’une réelle souffrance vécue et d’une attente pressante à ce sujet. […]
Quant aux jeunes générations, elles n’ont rien d’homogène, si bien que de grandes différences de sensibilités apparaissent clairement. Certains adolescents ou jeunes adultes expriment à l’égard de l’Église enthousiasme et confiance. Beaucoup d’autres disent leur attente d’une Église plus accessible et fraternelle, à tous niveaux : avec un langage plus compréhensible, des communautés plus ouvertes et accueillantes, capables de proposer un vrai ressourcement spirituel. […]
Beaucoup de synthèses signalent également l’intérêt de « tiers-lieux » : des lieux pensés pour permettre un dialogue avec les non-chrétiens, des lieux où il est possible de rencontrer des personnes qui n’entrent pas d’ordinaire dans les églises. C’est d’autant plus important que le langage de l’Église et de ses pasteurs apparaît largement difficile à comprendre, tant il semble déconnecté de l’expérience quotidienne. […]
Dans ce contexte, la mission de l’Église est presque toujours conçue sur le mode du dialogue et du partage d’expériences, pour deux raisons. D’abord, il importe d’accueillir ce que la société dans laquelle nous vivons nous apprend de bon ; on trouve ainsi quelques références à la préoccupation écologique partagée par les catholiques. Ensuite, un nombre considérable de synthèses sont habitées par la conscience qu’une profonde humilité conditionne le témoignage que l’Église peut donner et le service qu’elle est en mesure d’offrir. Toute tentative de donner des leçons est désormais irrecevable pour ceux à qui, précisément, on voudrait s’adresser. Les nombreuses demandes de formation à l’écoute et au dialogue attestent une recherche de cet ordre. […]
Les personnes en grande précarité identifient dans la lecture commune des Écritures un fondement de la vie ecclésiale. En méditant les textes, chaque participant expose sa vie et sa parole à la Parole de Dieu et peut entendre les appels que Dieu adresse à chacun et à l’Église. Ainsi, tous peuvent trouver leur place : personnes très précaires ou non, chrétiens pratiquants ou non…
On le voit, les terrains d’espérance ne manquent pas pour demain. S’ils dépendent en bonne partie de chacun de nous, ils dépendent maintenant en large part de la hiérarchie de l’Eglise. Celle-ci se donne encore un an pour s’en saisir dans un synode romain en 2023 et en tirer toutes les conclusions nécessaires.
Laurent Maurin
[1] Pour les ordinations d’hommes mariés. Nous constatons avec grande joie, Dimanche 3 juillet, dans et pour notre diocèse l’ordination presbytérale de Stephen. D’origine anglicane, marié, père de famille, il devient prêtre de l’Eglise catholique romaine pour notre diocèse d’Angoulême, renouant en cela avec l’antique tradition de l’Eglise interrompu au XI° siècle par la réforme grégorienne, validée en 1139 par le Concile de Lantran II, rendant obligatoire le célibat de prêtres.
De même nous accueillerons dans notre presbyterium en septembre, le P. Charles, venant du Liban (de rite maronite, uni à Rome), lui aussi marié et père de 3 enfants. Il est nommé curé à mi-temps de la paroisse Saint-Cybard sur Charente et Nouère sur notre doyenné du Grand-Angoulême.

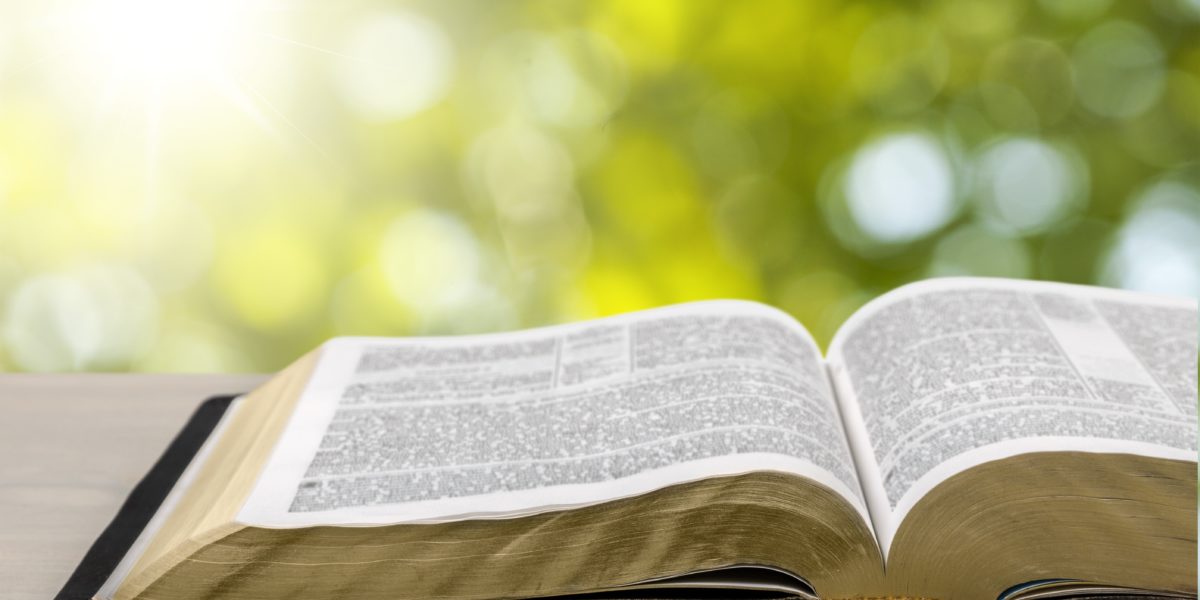
Laisser un commentaire