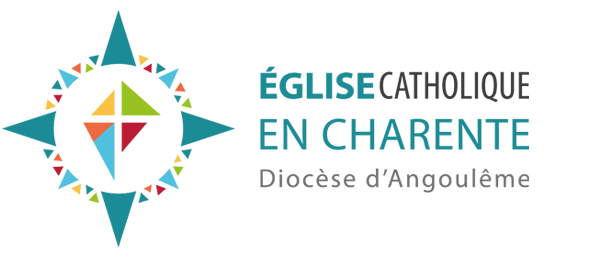Reconnaître la part de gratuité du soin
La gratuité dont il est question est à chercher dans l’ordre d’une attitude intérieure et pas d’abord à comprendre au sens pécuniaire du terme. Le soin est assuré par des millions de salariés mais aussi de bénévoles œuvrant dans des organisations ou aidant auprès de leurs proches. Et tous sont concernés par la question de la gratuité. Elle n’est pas une réalité anthropologique qui traverse notre humanité.
Evidemment son existence même n’est pas une évidence. Si en première approximation la gratuité se définit comme « ne rien attendre en retour d’un don ou d’une prestation », elle n’est pas de ce monde. Argent, reconnaissance, valorisation, narcissisation : qui peut affirmer qu’il est insensible à ces gratifications ? Qui est en mesure de s’exonérer des enjeux des enjeux psychologiques liés à la position de soignants : conjuration d’angoisses existentielles, frustrations, gestion de culpabilité névrotique, réassurance sur son utilité ? Ne sommes-nous pas en outre soumis à de multiples déterminismes familiaux, culturels, psychologiques qui nous engagent à une mise en conformité avec les systèmes de valeurs de la société, de son groupe ou de sa communauté ? De telles interrogations ne sont pas infondées et rendent compte de la complexité de ce qui anime les personnes qui s’engagent dans le don, le soin, le service, l’altruisme ou la philanthropie. Mais elles n’épuisent pas tout.
La gratuité n’est pas incompatible avec les parts de déterminisme de logiques psychologiques ou les attentes de gratification qui nous habitent. En outre, « ne rien attendre en retour » ne signifie pas « ne pas accepter de recevoir » ou « se fermer à ce qui pourrait être donné ». Nous en faisons l’expérience dans nos vies plus souvent qu’il n’y paraît. Elle est « ce qui vient en plus », de ce qui est fait par devoir, par besoin ou par nécessité. Pour reprendre le mot aussi simple qu’éclairant de Jean-Baptiste de Foucauld, elle est « ce qui pourrait ne pas être ». Une vie de famille ne peut pas se développer seulement avec un règlement intérieur au foyer et une justice entre ses membres; elle a besoin d’affection gratuite. La gratuité ne se conquiert pas; elle se reconnaît, se révèle et se donne à qui la cherche dans les gestes les plus simples. La question de Muriel Barbery (Barbery) sur la beauté pourrait s’appliquer à la gratuité: « Où se trouve-t-elle ? Dans les grandes choses qui, comme les autres, sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans prétendre à rien, savent incruster dans l’instant une gemme d’infini ? » I1arrive que nous en fassions l’expérience devant le beau, le bon, le don, l’amour, l’amitié… Le film La vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck, qui a notamment obtenu un Oscar en 2007 et un César en 2008, en est une magistrale illustration. Le personnage central, Gerd Wiesler, est un officier de la Stasi en ex-Allemagne de l’Est dans les années 1980. I1 est un subordonné zélé et efficace, maîtrisant et enseignant toutes les techniques de la surveillance et d’interrogatoires susceptibles de confondre les individus menaçants pour le régime communiste d’Erich Honecker. Il apparaît froid, insensible, sans âme. Son existence semble morne et ancrée dans la paranoïa. Dans son système de pensée, la seule valeur reconnue à une personne ou une activité est son utilité fonctionnelle quant à la survie de l’Etat. L’art doit ainsi choisir son camp: il subvertit le régime ou bien il en fait la promotion. Et 1’amour se réduit à une décharge pulsionnelle hors de toute affectivité déclenchée par une prostituée payée par la Stasi. Wiesler reçoit du ministère de la Culture la mission d’enquêter sur un couple d’artistes : Georg Dreyman, auteur à succès et Christa-Mari Sieland, actrice. Tandis qu’il progresse dans son enquête, sa fascination pour le couple grandit. À travers ce que vivent Georg et Christa-Maria, il fait la rencontre de l’art et de l’amour, gratuits… Entrant dans leur intimité, il fait l’expérience que la culture peut ne pas avoir de finalités politiques ou être instrumentalisée. Il découvre que la sexualité engage les corps mais aussi les affectivités. Qu’elle est en lien avec la parole, et qu’elle s’inscrit dans une relation entre deux personnes faite de passion, de réciprocité, d’amour et aussi de pardon. Le spectateur assiste aux phases successives d’écroulement du mur intérieur de Wiesler sous les coups de ces visages de la gratuité : l’incrédulité, l’incompréhension, l’acceptation, l’exploration, jusqu’à 1a protection des protagonistes à ses propres dépens. L’acmé du film est probablement atteinte dans la scène où, casque d’écoute vissé sur les oreilles, Wiesler entend l’interprétation au piano de La sonate de l’homme bon. « Une personne qui l’apprécie ne peut pas être un homme mauvais », dira Georg. Dans le même temps, ému jusque dans ses profondeurs par la beauté de l’oeuvre, les larmes couleront des yeux de Wiesler, restés secs depuis si longtemps ; signes extérieurs de la transformation de son âme. En citant Lénine à propos de l’Appassionata de Beethoven, Georg exprime la force de la beauté gratuite : (« Si je continue à écouter, je ne serai plus en mesure de terminer la Révolution. ») La rencontre que Wiesler a faite avec la part de gratuité qui peut exister dans une existence a fait de lui un homme bon.
Pourquoi l’autre est-il sorti du « donnant-donnant » ? Pourquoi m’a-t-il donné plus que je n’attendais ? Telles sont les questions suscitées par une attitude empreinte de gratuité. La gratuité nous fait entrer dans un mouvement qui nous dépasse, celui de la vie.
La gratuité est ce qui permet d’aller au-delà de la seule justice, du seul devoir de solidarité. Elle invite à reconnaître l’autre pour lui-même et pas parce qu’il est victime malade ou blessé. Elle fait quitter la réparation pour entrer dans une relation de reconnaissance réciproque. Par ce qu’elle signifie, la gratuité est ce qui va excéder les dimensions utilitaires et fonctionnelles. Le soin est ainsi doublement constitué : de contingence d’une part, de gratuité d’autre part ; d’intérêt pour soi et aussi d’attention désintéressée pour l’autre.
Le soin est fait d’une logique de technicité, s’appuyant sur des compétences et permettant des prestations médicales, sociales, psychologiques. Elles peuvent être évaluées, et gagner ainsi en efficacité. Mais ces prestations, en tant que telles, ne suffisent pas à une rencontre. La logique de gratuité, intimement mêlée à celle de technicité, permet alors de soigner en s’adressant à une personne dans sa singularité. Si bien que la gratuité ne transforme pas une situation mais une personne. El1e ne trouve pas un hébergement à un homme dans la rue, ni ne retire une masse tumorale dans le sein d’une femme. En revanche, elle peut en changer la souffrance et la relation avec elle.
Telle une femme ardente et pudique, la gratuité se livre à celui qui la désire avec force et délicatesse. Elle est une dimension essentielle dans l’existence, d’une personne. La vivre humanise d’avantage chaque homme, chaque femme. Nous en avons tous besoin pour exister et nous développer, pour porter la souffrance aussi. Reconnaître cette dimension s’appuie sur l’observation que recevoir et donner gratuitement approfondissent notre humanité commune.
Dans un texte intitulé Essai sur le don, Marcel Mauss montre la place incontournable du don en tant qu’il est « Un de ces rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés » (Mauss). D’un côté il est un phénomène social, porteur d’une valeur symbolique; de l’autre, il est un acte de reconnaissance mutuelle, ouvrant un cycle réversible à trois temps donner/recevoir/rendre.
Un monde sans gratuité serait un monde inhumain. Dans notre société libérale où les valeurs marchandes et leur langage s’imposent de fait, il est urgent de chercher ce qui échappe encore à la dictature de l’économique et du rentable. Il est pressant de trouver les lieux de gratuité et de leur faire place : l’art, le savoir, l’amour, l’être humain, le soin en sont. Toute chose, comme le dit le philosophe Éric Fiat, qui « n’est pas perdue quand on l’a donnée ».
Aujourd’hui, cette posture est difficile à tenir. Dans le monde de la marchandisation et de l’efficacité, dans une société où l’instrumentalisation de ses membres est parfois réalité, vivre cette gratuité est une gageure. Elle est de l’ordre du don et le don tisse le lien social. La société ne peut pas être constituée uniquement de droits et de devoirs. Le soin doit se déployer au-delà des frontières définies par les procédures et leurs évaluations. Là où l’utilitarisme fonctionnalise le corps et le réduit à un simple objet de la science ou du marché, la logique de la gratuité le situe en tant que sujet (Fixot). Tout ne peut pas être marchand. Une personne n’a pas de valeur vénale pas plus qu’une relation une valeur monétaire. La valeur d’une personne ne se mesure pas à son utilité ou ses qualités fonctionnelles : voilà ce qu’affirme la gratuité. Elle nous fait basculer du côté de l’Homme et de son mystère.
Les bénévoles, de par leur statut, sont des signes forts de cette gratuité. Ils n’en n’ont pas le monopole car être dans la gratuité est une disposition et une décision intérieures. Elle se concilie d’autant mieux avec le professionnalisme qu’ils ne sont pas dans le même champ. La gratuité est levain dans la pâte des compétences. Non seulement les prestations sociales ou médicales sont compatibles avec la gratuité mais elles ont à en être éclairées, traversées par elle. Les bénéfices pour la personne en sont démultipliés.
Cette question de la gratuité peut paraître bien idéale. Le pur altruisme n’est pas de ce monde, diront certains. Qui peut dire qu’il est dans la gratuité ? Nul d’entre nous assurément. Comme l’amour, elle transforme et invite à se mettre en chemin. Comme l’amour, elle nécessite d’être apprise. Comme l’amour, elle est décentrement. Nous saurons être sur sa route quand nous en tirons même le temps d’un éclair, que nous désirons l’autre vivant, juste pour lui-même.
Jean-Guilhem Xerri
Extrait de “le soin dans tous ses états”