Les fraternités Angoulême-Koudougou (Burkina Faso) se sont retrouvées à la maison paroissiale de Confolens le 20 octobre 2025. Retrouvez le compte-rendu des échanges de la journée.
fraternite-angouleme-koudougouPrière pour le Burkina Faso

Dieu Notre Père, ce qu’il y a de meilleur dans la création, c’est l’homme. Tu l’as créé à ton image afin qu’après le temps de sa vie terrestre, il jouisse d’un bonheur éternel auprès de toi.
Pour que notre pays soit le milieu de vie où nous obtenions cet unique nécessaire qu’est la vie éternelle, nous t’adressons cette prière :
Accorde à notre pays le Burkina Faso, les institutions qui lui garantissent le bien être, la liberté et la paix.
Accorde lui avant tout, les autorités religieuses et civiles qui se laissent guider par l’Esprit Saint , afin qu’elles exercent leurs charges selon la justice et dans le seul souci du bien de tous.
Nous te le demandons par ton fils Jésus le Christ, Notre Seigneur.
Très Sainte Vierge Marie priez pour nous,
Notre Dame de Yagma protégez notre pays,
Anges gardiens du Burkina Faso Veillez sur lui
contribution de l’abbé Roger Kologho
(Cliquer sur la flèche pour ouvrir le texte)
Entretien avec la fraternité Angoulême – Koudougou
Il m’a été demandé de partager avec vous un peu du monde des études que poursuivent les prêtres étrangers ou africains essentiellement en Europe et de manière particulière à Rome. A ce sujet, J’évoquerai, en premier lieu, l’initiative des formations, les disciples fréquentées et les conditions d’études. Je rétrécirai ensuite l’horizon au niveau de la recherche que j’ai entreprise depuis deux ans. Un élément culturel sera évoqué pour conclure ce temps d’échange.
- Les formations ultérieures
- L’initiative
S’il est des cas où le prêtre soumet à l’Evêque son désir de poursuivre une formation complémentaire dans tel ou tel domaine, aussi bien en Occident que dans les autres parties du monde, l’initiative appartient en général aux Evêques et à leurs conseils. Pour les disciplines ecclésiastiques, les professeurs des grands séminaires au Burkina font des propositions de candidats aux Evêques à la fin du cycle de formation. Naturellement ces derniers sont libres d’en tenir compte. Le prêtre, d’autre part, peut accepter ou décliner la proposition de son Supérieur. Après l’accord du prêtre, l’Evêque et les services mandatés s’occupent des modalités de financement des études : voyages, hébergement, santé et frais académiques.
- Les disciplines
L’offre de formation ecclésiastique supérieure est abondante en Europe. Beaucoup universités européennes sont réputées dans le monde. Que l’on pense à l’Allemagne, à la Belgique, à l’Espagne sans oublier la France et l’Italie. En Europe en général, des unités universitaires ont été créées dans les grandes circonscriptions ecclésiastiques pour rendre un minimum de disciples accessible aux différentes communautés. La ville de Rome abrite particulièrement une vingtaine d’universités et instituts pontificaux qui offrent des parcours dans toutes les disciplines ecclésiastiques et quelques autres civiles comme les sciences de l’éducation, les sciences juridiques, la psychologie et les sciences de la santé. Il y a des universités spécialisées dans certains domaines comme l’Université salésienne pour les sciences de l’éducation, l’Alphonsianum pour la morale, le Marianum pour la théologie mariale ou l’Institut biblique où je suis pour l’exégèse. Un projet de réforme des instituts est en cours en vue d’améliorer la qualité des cursus en favorisant des pôles de compétence. La faculté de morale est ainsi en phase de clôture à l’université Urbaniana au profit de l’Alphonsianum.
Les trois diplômes poursuivis sont le baccalauréat en théologie, catéchèse, philosophie, missiologie ou psychologie, puis la licence et le doctorat. Hormis le parcours commun à tous les prêtres pour le baccalauréat en théologie, les formations les plus longues sont celles en psychologie et dans les sciences de l’éducation car il faut 3 ans pour le baccalauréat, puis 2 pour la licence et de trois à quatre autres années pour le doctorat. Celles en morale et en théologie spirituelle semblent les plus courtes. On compte généralement 3 ans pour la licence canonique et 3 autres pour le doctorat. Là où je suis, on compte 4 et 4.
Les cours sont dispensés en italien et en anglais. Un certain niveau d’italien est exigé même si l’on n’entend pas suivre des cours dans cette langue. Pour cela, les nouveaux étudiants arrivent en général 3 mois avant la rentrée pour un cours intensif d’italien. Certains asiatiques ont besoin d’une année entière pour l’apprentissage de cette langue.
Statistiquement parlant, en 2022, il y avait 16.000 étudiants venant de 120 pays et des 5 continents dans les 22 structures universitaires, soit précisément 7 universités, 2 Athénées – Saint Anselme et Regina Apostolorum – et 9 Instituts, qui abritaient 2.000 enseignants, 600 personnels ; 15 congrégations, ordres religieux ou autres instituts ecclésiales étaient impliqués dans leur administration et animation. 3.000 diplômes avaient été délivrés. Les prêtres et les consacrés constituent la grande majorité des étudiants dans les disciplines ecclésiastiques. Beaucoup de laïcs italiens dans les universités fréquentent l’Université salésienne, celle du Latran et la Grégorienne qui proposent des disciples profanes déjà évoquées.
- Les conditions d’étude
Dans le cas particulier de Rome, il y a deux régimes : les collèges et les paroisses. Commençons par les paroisses. Les étudiants accueillis dans les paroisses de Rome et d’autres diocèses italiens signent une convention avec la Conférence Episcopale Italienne (CEI) à travers les diocèses. Le contrat prévoit une activité pastorale par time : l’étudiant peut vaquer à ses obligations d’étude du lundi au vendredi. Puis du vendredi soir au dimanche, il doit se mettre aux services de sa paroisse d’insertion. Pour ce service, il a droit à un logement et une indemnité mensuelle d’autour de 600 euros, avec laquelle il est censé pouvoir payer ses études et couvrir ses besoins. Certains curés ajoutent des intentions de messe, d’autres ne font pas payer la nourriture au titre des intentions s’il y a une table commune mais il en est qui semble-t-il ne donnent ni l’une ni l’autre chose. L’avantage de cette condition est économique car une certaine marge financière est accordée à l’étudiant étranger. L’inconvénient est que beaucoup de curés ne respectent pas les termes du contrat et sollicitent sans cesse l’étudiant. Pour cela ou pour d’autres raisons, au moins 20% des étudiants n’arriveraient pas à conclure leur cursus.
Il y aurait une cinquantaine de collèges dans la ville sainte et les environs. Certains appartiennent à des conférences épiscopales comme saint Louis des Français. La plupart des pays européens ont un collège à Rome. Les Américains, les Canadiens, les Mexicains, les Brésiliens, les Philippins, les Australiens et l’Amérique latine en ont aussi. Puis viennent les congrégations internationales. Etant donné qu’elles ont leur siège à Rome, des dépendances y sont réservées aux étudiants si non des maisons affectées, des collèges donc. Les étudiants des pays n’ayant pas de collèges comme les africains demandent à être reçus dans les collèges nationaux, ceux des congrégations ou encore dans des maisons religieuses disposant de chambres libres.
Il reste un dernier groupe de collèges, ceux de la Congrégation pour l’Evangélisation. Il y en a 4 : 2 pour les prêtres, 1 pour les religieuses et 1 pour les séminaristes. Le séminaire urbain est juste à côté du Vatican sur la colline qui surplombe la place saint Pierre, le collège saint Pierre où était l’Abbé Christophe est à 3 mn du Vatican, le collège saint Paul où j’ai résidé 4 ans à 15m. Le collège des sœurs est à Castel Gandolfo. Il y a un projet de transfert dans la ville, il semble que la maison soit déjà acquise mais nécessite des travaux et une augmentation de capacités. Ces quatre collèges sont les plus grands en termes de capacités et accueillent chacun au moins 150 étudiants /es. Le collège saint Paul peut en loger un peu plus de 200. On a plus de 600 personnes à la charge de cette congrégation : logement, santé, nourriture et frais d’université. Ce budget est entièrement supporté par les quêtes des œuvres pontificales missionnaires (OPM). Il est prélevé seulement à l’année 1300 euros sur l’aide destinée aux diocèses des pays de mission pour chaque étudiant à titre de pécule pour payer les livres, le bus et le nécessaire du quotidien. La baisse des quêtes depuis le début des années 2000 et la Covid ont un impact sur le fonctionnement des collèges. Entre 2019 et maintenant on voit déjà une différence dans les collèges. Il est demandé de faire des économies. Merci pour votre contribution à la quête du dimanche de la mission et aux autres quêtes. Vous faites une grande œuvre à Rome et dans les pays de mission.
Une caractéristique des collèges est qu’elles ferment entre un mois, celui d’août, ou trois pendant l’été. Les étudiants sont priés de rentrer dans leur pays ou de se faire accueillir dans des paroisses en Europe ou ailleurs. Voilà pourquoi l’Abbé Michel et d’autres prêtres accueillent des étudiants l’été.
Les collèges et les universités romaines sont des lieux où se manifeste véritablement l’universalité de l’Eglise. Dans le collège où j’étais il y avait 53 nationalités, il en est de même à l’Institut où j’étudie. Nous échangeons beaucoup sur les réalités de nos différents pays, de nos églises, des pratiques pastorales et des défis. Des amitiés se créent mais il y a aussi des tensions parce que nous venons de divers horizons. C’est une formidable expérience.
Pour donner une idée des prêtres de Koudougou à Rome. Nous étions 8 l’année dernière avec Mgr Janvier qui travaille à la communication vaticane. Les Abbés Christophe, Achille, Jean-Marie et moi-même étions dans des collèges ; les Abbés Augustin, Roger Koanda et Honoré étaient dans un diocèse voisin de Rome.
- L’exégèse biblique
2.1. le cycle de licence
Après ces brèves informations sur les études essentiellement dans le contexte romain, considérons maintenant la recherche que j’ai entreprise. A la différence peut-être des autres disciplines où il y a une quantité d’informations à posséder, on insiste beaucoup dans les études bibliques sur la méthodologie de recherche étant donné qu’il n’y a pas de dogmes. L’objet de l’exégèse est d’expliquer la signification de la parole de Dieu. Pour cela, la base est la connaissance des langues d’origine des Ecritures saintes – l’hébreu biblique, le grec du NT et l’araméen biblique. A cela s’ajoutent d’autres cours fondamentaux comme l’histoire de l’AT et du NT, l’herméneutique, la méthodologie, la critique textuelle et des introductions aux deux Testaments. Une fois cette base acquise après une année et demie ou deux, on doit choisir des cours d’exégèse et de théologie bibliques et des séminaires. En général, le professeur se propose d’étudier minutieusement avec les étudiants quelques chapitres qui forment une unité dans un livre biblique ou dans le cas des séminaires, les différents genres que l’on peut rencontrer dans un groupe littéraire comme les prophètes, les sages, les évangiles ou la littérature paulinienne. Outre les examens d’évaluation des cours, l’étudiant doit préparer un travail de séminaire entre 20 et 30 pages et un mémoire final de longueur variable selon le modérateur. Ces derniers travaux concluent le parcours de la licence.
2.2. La recherche doctorale
A l’Institut biblique, le parcours doctoral semble simple. Durant la première année, l’étudiant choisit un argument qu’il approfondit avec l’accompagnement de son directeur. A l’issue de la rédaction, un comité de trois professeurs, le directeur inclus, est constitué. Devant le comité, l’étudiant présente son travail pendant 15mn, puis chaque professeur dispose de 20mn pour lui faire des demandes. Puis le comité décide si le candidat a les capacités pour conduire une recherche ou pas. Si oui, l’aventure peut commencer : choix de thème, recherche, rédaction et soutenance en général au bout de 3 sinon 4 ans. L’université propose chaque année 3 séminaires aux doctorants et leur recommande de participer aux conférences et semaines d’étude. Je suis passé devant la commission le 17 décembre dernier et actuellement je travaille sur un thème large à mieux définir au fur et à mesure que l’étude avance : « une étude de la Vetus Syra de l’évangile de Jean ».
2.3. Problématique
Pour comprendre l’objet de l’étude, on peut se poser cette question : où se trouve l’original des bibles que nous lisons ? Nous n’avons plus les originaux des quatre évangiles par exemple. D’ailleurs nous ne savons pas absolument où ils ont été composés. Nous avons seulement des copies de copies des livres bibliques et des copies de traductions antiques. Le problème est que les scribes étaient des humains et qu’en copiant les manuscrits, malgré leur bonne volonté, ils ont fait des erreurs. Certains n’ont pas hésité à modifier par moment le texte, à l’allonger ou à apporter des éléments trouvés ailleurs. L’épisode de la femme adultère est absent de certains manuscrits antiques, ce qui veut dire que probablement il n’est pas original mais a été inséré plus tard dans l’évangile de Jean. Voilà pourquoi, il y a des versets ou des paroles que nous lisions dans des bibles anciennes que nous ne trouvons plus dans les bibles actuelles parce que jugés aujourd’hui non authentiques – l’ange qui descendait agiter l’eau Jn 5. On essaie de reconstituer les textes originaux en comparant tous les manuscrits dont nous disposons pour écarter les erreurs et les ajouts postérieurs. Ce travail est un domaine des études bibliques que l’on appelle critique textuelle.
Ce ne sont pas seulement les mss grecs que l’on utilise dans ce travail et dans l’exégèse en général mais aussi les traductions antiques comme la Vetus Latina et la Vulgate, la Vetus Syra et la Pshitta, le copte et l’éthiopien. Les premières traductions du grec dans ces langues ont commencé à la fin du 2° siècle ou au début du troisième en Afrique, en Syrie, en Egypte puis en Italie et en Gaule. Ils sont donc des témoins privilégiés des copies du NT qu’ils avaient en main et ont traduites. Mais certains se demandent si les traductions sont fiables. Et ils ont raison car il suffit de regarder dans les traductions modernes pour voir en quoi traduire était et est complexe. Comme exemple, on peut prendre Jn 6,49 et comparer le texte grec avec la TOB et la traduction antique en syriaque.
| Original Grec | TOB | Old Syriac |
| οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. | ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܡܘܬ | |
| Ceci est le pain qui du ciel descend afin que chacun en mange et ne meure pas. | mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. | Ceci est le pain qui du ciel descend afin que chacun en mange et ne meure pas. |
On note que le syriaque rend assez fidèlement le G mais la TOB a un contenu un peu sinon bien différent de la déclaration de Jésus. Au-delà de la traduction littérale, la TOB propose une théologie différente de celle de G et il serait intéressant de voir sur tout le chapitre les écarts de traduction et la théologie qui en résulte.
Prenons un autre exemple qui nous est familier. Quand les grands-prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour arrêter Jésus, ceux-ci revinrent et s’entendirent demander : « pourquoi ne l’avez pas amené ? » et donnèrent cette réponse en Jn 7,46 :
| οὐδέποτε ⸂ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος⸃ | K Γ Δ Θ ƒ1.13 : οὐδέποτε ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος | OS : ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܠܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܕܡ ܕܡܠܠ ܓܒܪܐ ܗܢܐ | P : ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ |
| TOB : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » | Jamais un homme n’a parlé de la même manière comme cet homme. | Jamais un homme n’a dit les choses que cet homme a dites. | Jamais un homme n’a parlé de la même manière comme cet homme a parlé. |
On voit ici que la réponse des gardes est si dense que les traducteurs ou les scribes renoncent à la rendre mot pour mot mais la développent. A l’échelle d’un chapitre ou d’un livre biblique, ces types de changements s’accumulent et l’on pourrait se retrouver devant un volume de lectures divergentes qui fait du texte traduit comme un texte différent de l’original.
Il y a un siècle, la tendance dans le domaine de la critique textuelle était de rejeter avec énergie ces types de changements en se consacrant essentiellement à la recherche du texte original. Depuis quelques décennies, tout en poursuivant l’objectif d’identification des textes bibliques sortis des mains des auteurs, les chercheurs accordent plus d’attention à la richesse du monde des traductions mais aussi des copies individuelles des livres d’écritures saintes. On en vient à traiter les traductions et copies antiques comme des versions en soi à approfondir et comme porteurs de message en lien avec des communautés chrétiennes de l’antiquité. Dans ce sens, la demande que je pose est : quelle est la richesse de la première traduction de l’évangile de Jean dans la langue syriaque, l’araméen de l’est de la Syrie antique ? Tel est le but de la recherche.
2.4. Quelques exemples de lectures divergentes
Dans le deuxième exemple déjà pris, nous avons constaté que la traduction grecque a intensifié la portée de la confession des gardes. Permettez-moi de vous proposer seulement quelques autres exemples de variations de mots par rapport à des versets que nous connaissons beaucoup.
- Un premier pourrait être l’épisode de la femme adultère en Jn 8,1-11. Ce passage n’existe pas dans l’antique traduction syriaque. Non seulement ici mais aussi dans les mss considérés comme les meilleurs. Si jamais les auditeurs syriaques connaissaient cette page d’évangile, ce n’était pas à travers l’évangile de Jn. Il faut imaginer donc un évangile de Jn sans cet épisode dans ces communautés et ailleurs.
- Un deuxième exemple pourrait être une inculturation. En Jn 6,9, Andrée répond à Jésus : « ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια / il y a ici un enfant qui a cinq pains d’orge et deux poissons » ; en Syriaque, on a : ܥܠ ܛܠܝܐ ܚܕ ܐܝܬ ܬܢܢ. ܚܡܫ ܓܪܝܨܢ. ܕܣܥܪܐ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ./ Chez un enfant il y a ici cinq gâteaux d’orge. Peut-être que dans le contexte de l’auteur, on ne faisait pas de pain avec de l’orge mais autre chose. Il adapterait alors la traduction ici au quotidien de son public.
- De manière presque systématique, le traducteur simplifie les introductions des réponses de Jésus et des autres. Le texte grec adopte la formule biblique où les réponses sont précédées par : un tel répondit et dit. Le syriaque traduit simplement : un tel dit ou il dit. On retrouve ainsi des séquences sans distinction : et il dit… et il dit… et ils dirent… C’est au contenu que l’on peut distinguer les acteurs.
- Un autre phénomène est ce que l’on appelle harmonisation. C’est le cas en Jn 6,11 :
| Mc 6,41 | S | Jn 6,11 | S |
| καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. | ܘܢܣܒ ܗܘ ܠܗܢܘܢ ܚܡܫ̈ܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢ̈ܝܢ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܒܪܟ ܘܩܨܐ ܠܚܡܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܦܠܓܘ ܐܢܘܢ ܠܟܘܠܗܘܢ | ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. | ܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܝܫܘܥ ܗܢܘܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܘܢܝܢ ܘܬܠܐ ܒܫܡܝܐ ܘܒܪܟ ܥܠܘܗܝ ܘܩܨܐ ܐܢܘܢ ܘܦܠܓ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܩܕܡ ܣܡܝܟܐ |
| TOB : Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. | Celui-ci reçut les cinq pains et les deux poissons, regarda au ciel et rendit grâce, il rompit les mains et les donna à ses disciples afin qu’ils les posent devant eux ; il divisa ces deux poissons pour eux tous. | Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. | Alors Jésus reçut les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, dit la bénédiction sur eux, les rompit et partagea à ses disciples afin qu’ils les posent devant les commensaux. |
Le changement est théologique. Le texte johannique oùJésus nourrit directement les auditeurs est substitué par la version synoptique où les disciples sont des intermédiaires.
- En Jn 6,13, on a un exemple d’intensification. Parallèlement à Mt 14,21 ; Mc 6,44, le syriaque de Jn précise seulement à la fin du miracle le nombre de bénéficiaires omis en 6,10 intentionnellement pour donner une idée plus forte, comparative du miracle : ܗܘܘ ܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܟܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܐܠܦܝܢ ܚܡܫܐ. Il donne en même temps le nombre de paniers ramassés et le nombre de ceux qui avaient mangé.
Un autre exemple pourrait être les omissions ou économies. Le traducteur peut sous-estimer certaines paroles et les omettre ou les omettre pour donner une importance plus grande à d’autres. Ainsi en Jn 6,20 :ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε / Mais il leur dit : « C’est moi, cessez d’avoir peur », est traduit en C par : ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ C a omis μὴ φοβεῖσθ. / Mais il leur dit : « c’est moi ». Jésus n’apaise donc pas la peur des disciples. A moins que le traducteur syriaque suppose que ces paroles très fortes suffisent à les rassurer. On a alors un changement exégétique important.
- Ajoutons encore un cas d’aggravation du récit. En 7,49 les grand-prêtres et les pharisiens expriment leur mépris de la foule qui croient en Jésus en disant : ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν / mais cette foule qui ne connaît pas la loin, est maudite. C traduit ainsi : ܐܠܐ ܐܢ ܩܘܛܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܘܪܝܬܐ ܕܠܝܛܝܢ ܐܢܘܢ. / mais cette populace qui ne connait pas la loi, est maudite. Le terme grec pour foule est ὁ ὄχλος et il est constant dans tout l’évangile. Le traducteur syriaque utilise au contraire 12 termes différents quand il rencontre ὁ ὄχλος. Ici le terme : ܩܘܛܢܐ signifie populace, masse. OS ajoute une note de dépréciation au terme neutre employé par G. Il caractérise la suffisance des grands prêtres.
- Ajoutons un dernier cas. C’est la difficulté du syriaque à rendre la demande rhétorique négative. Prenons la demande de Nicodème à ses collègues au sujet de Jésus en Jn 7,51 :
| μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ’ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; | TOB | ܕܠܡܐ ܠܘܩܕܡ ܐܘܪܝܬܐ ܕܝܢܐ ܠܒܪܢܫܐ ܥܕܠܐ ܢܫܡܥ ܡܢܗ ܘܢܕܥ ܡܢܐ ܥܒܕ. |
| Notre loi condamne-t-elle quelqu’un si elle ne l’a d’abord écouté et su ce qu’il fait ? | Notre Loi permet-elle de juger un homme sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? | Est-ce que primordialement la loi condamne-t-elle quelqu’un tant qu’elle ne l’a pas entendu et su ce qu’il fait ? |
Ce bref aperçu nous permet de voir l’étendue des choix que font les traducteurs syriaque et les changements dans la lecture du texte évangélique. Il n’est cependant pas possible de prévoir la direction qu’ils peuvent prendre, intensifier le texte ou omettre sinon diminuer la portée de certains passages ou mots. On ne s’ennuie pas en comparant les versions mais il ne sera pas facile de parvenir à une synthèse de la technique de traduction. C’est le premier objectif que je souhaite atteindre et dans une deuxième partie, j’essaierai d’approfondir la portée théologique ou littéraire de certains changements. Ce n’est pas un travail d’utilité immédiate mais indirectement, il pourrait permettre de comprendre davantage l’évangile de Jean.
- La parenté à plaisanterie
En troisième lieu, il m’a été demandé d’aborder une pratique sociale familière au Burkina Faso mais aussi dans d’autres pays africains, en Amérique du Nord, en Océanie, en Europe et sur d’autres continents sous une forme ou une autre : la parenté à plaisanterie. Les spécialistes proposent d’opérer une distinction entre la parenté à plaisanterie et les alliances intracommunautaires et interethniques. Il s’agit de relations sociales qui « se jouent sur le registre humoristique de la licence de langages et d’attitudes qui engendre des rapports aisés et sans gêne avec tous les parents proches » (Yonaba, 14). Contrairement aux rigides principes habituels de respect du sacré, de l’autorité et de l’autre, ici « il y a l’insulte et l’incorrection, il y a la brimade et le sans-gêne ; en face du devoir sans borne et sans contrepartie, il peut y avoir des droits sans limites et même sans réciprocité dans certains cas » (Mauss, 1969, 111). Concrètement, ce type de composante de vie sociale est « une formalité relationnelle ‘entre deux personnes [ou deux groupes] dans laquelle l’une est autorisée par la coutume, et dans certains cas, obligée de taquiner l’autre ou de s’en moquer ; l’autre de son côté, ne doit pas en prendre ombrage’ » A titre d’exemple, en Océanie et Mélanésie, il y a des communautés où une licence langagière et relationnelle est permise entre le neveu et l’oncle maternelle.
Le modus operandi est le même mais il y a une distinction entre la parenté à plaisanterie et les alliances interethniques. Ainsi on limite le concept de parenté à plaisanterie au cercle familial, il repose sur le lien de consanguinité. L’alliance de plaisanterie se fonde sur l’institution, l’habitude sociale ou encore l’histoire et s’étend de groupes au sein d’une même communauté ou d’une même catégorie sociale ou professionnelle à des quartiers, villages ou d’autres autres catégories sociales et professionnelles jusqu’au niveau des ethnies.
Cette distinction de base et entre les différentes catégories et groupes sociaux s’observe au Burkina Faso. A titre d’exemple de parenté à plaisanterie chez les Mosse, la femme mariée peut plaisanter de manière hasardeuse avec ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Elle peut appeler mon mari aussi bien le frère que la sœur parce qu’ils équivalent à son mari et inversement. La familiarité qu’elle peut entretenir avec l’époux est transposée avec les frères et sœurs de ce dernier en raison de la consanguinité – j’ai un petit frère qui est mariée et sa femme m’appellerait mon mari et mes sœurs ou même mon frère me parleront d’elle en me disant : il faut dire à ta femme de ne plus faire ceci ou cela. Si je leur demande : ma femme ? Elles me répondront étonnées : mais alors la femme de Parfait ou notre femme-là. En raison de l’alliance du mariage, les frères de l’épouse peuvent aussi user d’humour à l’égard des frères et sœurs ou même la famille par alliance.
Au niveau des alliances de plaisanterie, on peut noter qu’il y a des familles précises exerçant réellement la licence de langage envers tous. Dans les discussions, on peut le deviner et alors on peut demander à la personne, généralement des femmes : es-tu une wemba ? Si, oui, même si la parole avait été jugée offensante, l’affaire se termine là. Des villages peuvent faire l’objet de dérision pour un ensemble d’autres villages pour des faits historiques. D’autre part, entre quartiers d’un même village ou entre villages, il existe des alliances qui permettent aux habitants de l’un et l’autre de se lancer des pics et d’avoir des discussions apparemment orageuses quand ils se rencontrent. Il y a ainsi une alliance de plaisanterie entre un village s’appelant Nandiala, voisin du mien, Villy, dans laquelle nous nous accusons mutuellement d’être des voleurs, des mangeurs d’arachides ou de gens de peu d’intelligence. Au dernier niveau, il y a des alliances entre les ethnies du Burkina. Les Mosse plaisantent ainsi avec les Samo. Les Yadsé plaisantent avec les Lyela/Gourounsis et les Gourmantché. Les Lyela pour leur part, plaisantent aussi avec les Bissas. Les Peuls sont liés aux Bobos. Il y a même des chants de dérision qui sont devenus des classiques. Dans des situations de tension sociale, une personne de l’autre groupe peut user de la liberté pour exiger la fin de la discorde. De même quand dans une situation orageuse, on découvre que l’autre appartient à un groupe allié, la crise est tournée en dérision et l’on passe à autre chose. Dans les moments de deuil, l’humour peut servir à atténuer la douleur. Certains ont pu assister à des scènes incompréhensibles pour l’observateur extérieur, quand des alliés interpellent le mort en l’accablant d’injures et en lui demandant de se lever s’il le peut ; au moment de la sépulture, certains se saisissent du cercueil et exigent d’être payés symboliquement avant de livrer le corps, ou même descendent dans la tombe et l’occupent en exigeant ceci ou cela. Durant la maladie, le ton léger peut également redonner le sourire à qui n’y a pas le cœur.
Les sciences humaines ont cherché à approfondir cette réalité présente dans plusieurs cultures et sur presque tous les continents. Il s’agit probablement d’une espèce d’autodérision inventée pour relever les torts et défauts du groupe d’en face, apporter de la sérénité dans le climat social, dépasser des passifs historiques ou sociaux importants et comme moments de détente, de loisirs dans des sociétés qui avaient des lois rudes sous certains aspects. Les moments de plaisanterie entre alliés sont avant tout des rencontres, des dialogues, une célébration de l’amitié humaine et de la joie.
- Conclusion
Il est temps de s’arrêter. Aussi bien les années d’étude que le phénomène social à peine évoqué sont des moments et réalités passionnants. Au fond, la plaisanterie dans la famille et par alliance s’enracine dans la reconnaissance du visage fraternel et de la volonté de construire avec lui un monde de joie, d’humanité. La volonté et l’amour avec lesquels vous vous engagez dans la fraternité sont une manifestation de la même réalité passionnante. Pour vous, ceux qui sont loin et seulement différents en raison de la culture et de l’histoire sont des frères et sœurs avec qui il est un devoir de bâtir un monde meilleur, avec qui il est urgent de partager l’aventure de la foi en Jésus Christ, Dieu incarné, Frère de tous et toutes, de chacun et de chacune ! Merci beaucoup aux pionniers, pionnières et à ceux et celles qui entretiennent la flamme aujourd’hui malgré l’âge et la maladie.
Y Barka Wusgo !
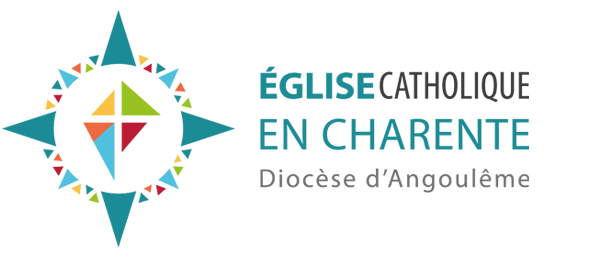






Laisser un commentaire